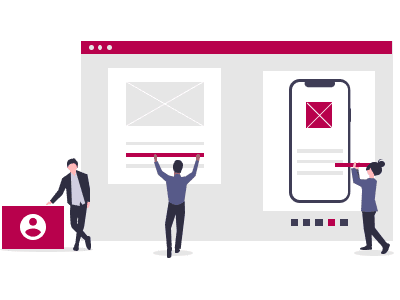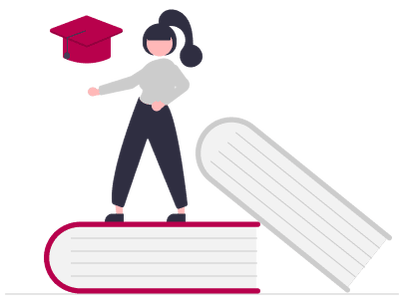Élaborer des politiques commerciales durables pour un impact plus large
Le Forum du commerce s'est entretenu avec Patricia Fuller, PDG de l'Institut international du développement durable (IIDD).
L'IIDD travaille sur le commerce international depuis deux décennies et l'analyse sous de multiples angles. Cet entretien est l'occasion de revenir sur les tendances du commerce durable ainsi que les implications des politiques relatives au changement climatique sur le commerce international.
R : Une tendance que j'observe déjà et qui, je l'espère, continuera à se développer, est que les décideurs politiques prennent en compte les impacts plus larges des politiques économiques, en particulier de la politique commerciale, qui était autrefois abordée de manière isolée.
Il ne s'agit pas seulement de créer des emplois dans une industrie exportatrice, mais aussi de savoir si ces emplois sont inclusifs et contribuent à l'équité entre les genre ; pas plus il ne s'agit de réformer les subventions agricoles en raison des distorsions commerciales qu'elles créent, mais d'envisager ces réforme afin de préserver la santé des sols et la biodiversité.
L'élaboration des politiques commerciales devient plus holistique et plus complexe, comme il se doit.
R : Les décideurs politiques, les entreprises et les acteurs de la société civile doivent tenir compte de cette complexité. Les ministères du commerce doivent consacrer davantage de temps à comprendre les priorités du reste du gouvernement dans des domaines tels que l'adaptation climatique et réfléchir à la manière d'élaborer – voire de co-élaborer – une politique commerciale au service d'un objectif plus large.
Cela signifie également qu'il nous faut mieux communiquer sur la manière dont le commerce et les politiques commerciales peuvent contribuer à la réalisation des objectifs sociaux et environnementaux et, surtout, sur les compromis possibles.

R : L'interaction entre les politiques climatiques et le commerce international et la compétitivité est l'un des sujets les plus difficiles en matière de politique commerciale, et l'un des plus importants à résoudre. À l'IIDD, nous considérons que notre rôle est de montrer aux gouvernements et aux parties prenantes comment ils peuvent faire progresser l'ambition climatique tout en étant justes envers leurs partenaires commerciaux.
Les ajustements carbone aux frontières (ACF) en sont un bon exemple. Ils permettent aux pays de demander à leurs producteurs industriels à forte intensité d'émissions de payer un prix croissant pour les émissions de carbone, mais ils entraîneront inévitablement des frictions commerciales et des problèmes d'équité car les exportateurs de certains pays devront faire face à des coûts plus élevés.
Le respect des nouvelles exigences en matière de rapports représente également un défi plus important pour les petits producteurs et les producteurs des pays qui disposent de moins de capitaux et dont les gouvernements sont moins à même de fournir un appui.
En outre, face au développement de mécanismes ACF différents selon les pays, les producteurs pourraient être confrontés à des systèmes de déclaration multiples. L'idéal serait de s'accorder sur des normes internationales pour mesurer le carbone incorporé dans différents produits, et d'ici là, de rendre interopérables les différents systèmes de déclaration ACF afin d'alléger la charge qui pèse sur les producteurs – en particulier les petits producteurs – de biens industriels à forte intensité d'émissions.

R : Les petites entreprises sont essentielles à l'économie mondiale, en particulier dans les pays en développement. Selon la Banque mondiale, elles représentent environ 90 % de l'ensemble des entreprises dans le monde et contribuent à 40 % du produit intérieur brut dans les économies émergentes. À ce titre, elles ont un rôle clé à jouer pour faire avancer les agendas du commerce et du développement durables, par exemple en appuyant la conservation des forêts et de la biodiversité, ainsi que la restauration des écosystèmes.
D'un autre côté, il faut mettre en place des politiques et des réglementations qui encouragent ou obligent les petites entreprises à adopter des pratiques de production et de commerce plus durables. À cet égard, les petites entreprises, en particulier dans les pays en développement, ont également besoin d'incitations financières telles que des subventions vertes ou des paiements pour services environnementaux, ainsi que d'un appui sous forme de connaissances, de services de vulgarisation et de technologies, afin de mieux aligner les objectifs en matière de commerce, d'environnement et de développement.
R : Pour prendre un exemple tiré de notre propre travail, l'IIDD appuie les décideurs et les praticiens (tels que les acteurs des chaînes de valeur et les organismes de normalisation) pour s'assurer que leurs interventions appuient les petits exploitants agricoles. À Madagascar, nous avons collaboré avec le gouvernement pour élaborer une stratégie nationale pour l'agriculture biologique, qui comprend des mesures visant à appuyer les petits exploitants, comme la création d'une banque de semences biologiques et la promotion de l'approvisionnement public en produits agricoles biologiques.
Au Cambodge, nous aidons le gouvernement à mettre au point des outils susceptibles d'encourager les agriculteurs à intégrer la question de la durabilité dans leurs plans d'entreprise. Nous travaillons également en étroite collaboration avec les organismes de normalisation sur les moyens d'augmenter les récompenses financières octroyées aux agriculteurs qui adoptent des pratiques de production plus durables, par exemple en offrant des primes obligatoires qui reflètent les avantages en termes de durabilité des pratiques agricoles respectueuses de la nature, ou d'autres formes d'incitations financières.